Le docteur Bolesław Piecha est un médecin connu en Pologne pour ses prises de position contre l’avortement. Devenu vice-ministre de la santé sous le gouvernement conservateur des frères Kaczyński, il s’est exprimé sur son expérience de l’avortement et sur le film documentaire américain Le cri silencieux du docteur Nathanson, sorti en 1984, qui lui a ouvert les yeux. L’entretien a été conduit pour l’hebdomadaire catholique Gość Niedzielny en 2007 et, à l’occasion de la Marche pour la Vie du dimanche 19 janvier, je l’ai traduit pour Nouvelles de France avec l’aimable autorisation de la rédaction du magazine polonais. Le docteur Piecha n’est pas le seul gynécologue-obstétricien à avoir changé d’avis sur l’avortement après avoir visionné le film du docteur Nathanson que nous mettons en lien sous l’entretien. Un film que les milieux pro-choix accusent pourtant de contenir de nombreux mensonges et manipulations, mais le docteur Piecha, qui a pratiqué des centaines d’avortements au début des années 80, n’est pas de cet avis. Pour lui, ce film ne contient aucune contre-vérité et il décrit bien la réalité de ce qu’on appelle pudiquement en France les «IVG».
«Je ne sais pas si ces femmes qui pleuraient dans mon cabinet avant l’avortement m’ont pardonné», dit le vice-ministre de la santé polonais Bolesław Piecha dans un entretien avec la journaliste Barbara Gruszka-Zych.
Barbara Gruszka-Zych : Un nouvel être humain ne reste dans le ventre de sa mère que pendant 9 mois. Cependant, nombreuses sont les femmes qui considèrent que puisque leur utérus leur appartient elles ont le droit de tuer l’enfant qui grandit à l’intérieur.
Bolesław Piecha : C’est un grave problème éthique. Même chez les peuples préchrétiens, la femme enceinte avait un statut particulier. Elle était tabou, il était interdit de lui porter atteinte, on sentait que l’état dans lequel elle se trouvait la distinguait des autres. Aujourd’hui, la science médicale nous dit que le moment où une nouvelle vie apparaît, c’est quand le spermatozoïde rencontre l’ovule, c’est-à-dire le moment de la fécondation qui survient après un rapport sexuel. C’est un véritable miracle de la nature. À chaque fois, c’est une nouvelle personne qui est créée, avec son propre code génétique, ses prédispositions et ses talents uniques qui continueront de se former toute sa vie. De nombreux psychologues affirment que l’enfant perçoit dès la période prénatale différents stimuli qui influencent déjà son développement. On ne croît plus à l’idée de tabula rasa à la naissance de l’enfant. Il y a plusieurs décennies, quand un enfant venait au monde à la 28e ou à la 30e semaine de grossesse, on considérait qu’il n’était pas viable. Aujourd’hui, on arrive à sauver des prématurés à un stade toujours plus précoce de la grossesse. Chacun, quelle que soit sa vision du monde, a une sensibilité éthique et sait que certaines normes ne doivent pas être transgressées et qu’il ne faut pas causer du tort à une vie conçue.
Et pourtant, sous le régime précédent [le régime communiste, ndlr], les gynécologues devaient souvent agir contre leur conscience en procédant à des avortements.
J’ai fini mes études en 1981 et ensuite j’ai exercé ce métier pendant près de 20 ans. Je suis sorti d’une école où on ne discutait jamais de notre vision du monde. Pour réaliser les avortements, il fallait déshumaniser les futurs médecins, leur faire perdre leur capacité d’empathie pour les personnes qu’on ne voit pas parce qu’elles sont cachées dans le ventre d’une mère. À l’époque, nous ne pouvions pas voir ces enfants car les nouveautés techniques comme l’échographie sont apparues plus tard. Par contre on voyait les effets des interventions d’interruption de grossesse conduites à grande échelle.
Qu’est-ce qui conditionnait ces interruptions de grossesse ?
La loi de l’époque prévoyait de nombreuses conditions permettant une telle intervention. Une des conditions les plus souvent invoquées, c’était la situation matérielle difficile de la femme enceinte. Il y avait tout un système en place pour pouvoir faire des avortements sans scrupules. On sortait de la tête des médecins et des femmes que l’enfant qui se développe dans l’utérus est un être humain. La tendance, c’était d’opacifier les choses au maximum. Pour parler de l’enfant conçu, nous utilisions des termes de substitution : les tissus, le trophoblaste, le zygote, le fœtus, l’embryon. Nous faisions exprès car ces termes n’avaient pas de charge émotionnelle, ils ne comportaient pas de jugement moral sur ce que nous faisions. La mère était soumise aux mêmes mécanismes. On ne lui disait pas qu’elle «interrompt sa grossesse en tuant son enfant» mais qu’elle donne son aval pour retirer les tissus, le fœtus, etc.
Quand avez-vous commencé à désigner les choses par leur nom ?
Le mot «enfant» a commencé à être utilisé au milieu des années 80 quand avec l’élan de Solidarnosc les gens sont devenus plus courageux. Je travaillais alors avec des psychologues qui militaient pour une organisation pro-vie. La première projection de film à laquelle ils nous ont invités nous a secoués, moi et mes collègues. C’était en 1984, je travaillais alors au service de gynécologie de l’hôpital de Rybnik où naissaient 4500 enfants et où il y avait des milliers d’avortements. Les milieux pro-vie ont organisé une projection privée pour nous dans une salle de la cure de l’église de Rybnik. Nous étions trois médecins gynécologues. Nous avons regardé Le cri silencieux de Nathanson.
Vous vous souvenez comment vous avez réagi aux images de cet enfant qu’on tuait ?
Oui, je m’en souviens. En réalité, chacun d’entre s’imaginait déjà cet acte tel qu’il est présenté dans ce film. Mais nous avions très bien intégré les mécanismes de refoulement de la vérité et nous n’y pensions pas au quotidien. Or ce film montrait que ce à quoi on ne pensait pas pouvait être mis en images, et que tels sont les faits mis à nus. Après la projection, il y a eu un grand silence. Nous étions atterrés. Les gens des milieux pro-vie présents dans la salle ont eu beaucoup de tact. Ils ne nous ont adressé aucun reproche. Et c’est sans doute ce qui nous a le plus touché, cela a débloqué nos consciences. Ces militants pour la vie, si pleins de tact, je les ai plus tard rejoints…
Comment les avortements se passaient-ils ?
J’ai parlé du nécessaire mécanisme de refoulement de la vérité dans le subconscient. C’était un double drame. Je sentais tout le temps que ce que je faisais n’était pas bien, et comme j’avais été élevé dans une famille catholique, je le ressentais doublement. Et il y avait ces remords qu’il fallait étouffer.
Vous avez vu des bras, des jambes d’enfants avortés ?
Bien sûr qu’on les voyait. Ce n’est pas une masse informe, une simple membrane, après le curetage de l’utérus. Chaque gynécologue qui a pratiqué des avortements a vu des fragments de corps d’enfant. On mettait alors nos masques de durs et on devenait stricts et agressifs. C’était une forme d’autodéfense indispensable. Les entretiens que j’avais alors avec les femmes qui venaient pour se faire avorter étaient secs et, quand j’y repense aujourd’hui, je les trouve scandaleux. J’essayais de faire porter toute la faute à la femme en montrant que sa situation ne faisait que me donner un surcroît de travail, à moi, gynécologue.
Vous ne les incitiez pas à renoncer à l’avortement ?
Il n’en était pas question, je me serais contredit moi-même. Mon approche consistait à rejeter la responsabilité sur la femme enceinte, à considérer que tout est de sa faute et pas de ma faute à moi, médecin. J’étais en colère contre la femme qui venait me voir avec son problème. Elle, elle ne savait pas l’exprimer, mais personne ne l’aidait à le faire. Parfois elle pleurait, et cela était encore plus énervant. Nous ne donnions pas à ces femmes l’occasion d’expliquer leur situation. «Si elle est là, c’est juste pour me causer des problèmes et me donner un surcroît de travail». Telle était la meilleure version et cela rejetait pour un moment la responsabilité sur quelqu’un d’autre que moi. Par conséquent, on ne voyait pas la nécessité de poser des questions concernant le sens de la vie ou même d’avoir une conversation quelconque. Et pourtant, la décision d’avorter d’une femme témoigne toujours du fait qu’elle se sent prise au piège, qu’elle manque de soutien. Et même chez le médecin où elle aurait dû trouver un soutien, on ne la consolait pas.
Après de telles interventions, les médecins aussi souffrent d’un syndrome post-abortif…
On sait aujourd’hui que ce syndrome ne concerne pas que les femmes. Jusqu’ici il était décrit dans les manuels, mais uniquement en ce qui concerne les femmes, jamais en ce qui concerne le personnel médical réalisant des avortements. On a conservé des descriptions de la Deuxième guerre mondiale qui parlent des comportements d’auteurs de la mort d’innocents. On peut déduire de ces descriptions que cela n’était pas neutre pour eux, qu’il y avait des traumatismes psychiques. Moi aussi, je me sentais mal. Je m’irritais quand quelqu’un parlait des interventions, mais j’en faisais une comédie. C’était parfois macabre. Et puis il y avait mon côté hédoniste : les fêtes, les amis. Il fallait étouffer les remords. J’étais plutôt agressif, y compris avec le personnel sous ma responsabilité. Quand une infirmière ne voulait pas m’assister dans une intervention, je hurlais que j’allais la renvoyer.
Vous en avez renvoyées ?
Ce n’est jamais arrivé, mais cette agressivité nous accompagnait. Tout le monde était nerveux…
«J’étais par vocation gynécologue-obstétricien. D’un côté, pendant quatre ans, je faisais ces maudits avortements, et d’un autre j’accompagnais les naissances. J’étais comme le docteur Jekyll et mister Hyde.»
Les femmes qui accouchaient devaient le ressentir…
J’étais par vocation gynécologue-obstétricien. D’un côté, pendant quatre ans, je faisais ces maudits avortements, et d’un autre j’accompagnais les naissances. J’étais comme le docteur Jekyll et mister Hyde. Mais c’est seulement après avoir vu le film que c’est devenu totalement insupportable. Ce film m’a ouvert les yeux. Refouler les faits dans mon subconscient ne suffisait plus, j’ai commencé à prendre des calmants. Je buvais aussi plus d’alcool… Il a fallu que je diagnostique moi-même mon syndrome. Bien entendu, je ne suis pas devenu néophyte du jour au lendemain. Mais j’ai commencé à éviter les avortements.
C’était possible ?
C’était difficile, mais pas impossible. Je tombais malade, je laissais ma place à un collègue… Je me comportais de manière infantile.
Que ce serait-il passé si vous aviez ouvertement refusé de faire des avortements ?
On m’aurait tout simplement renvoyé. Par bonheur, mon chef de service a lui aussi vu «Le cri silencieux». Lui aussi a changé d’avis sur les avortements et il a cessé de nous obliger à les pratiquer. Mais après un an d’esquives, il a fallu se déclarer. J’ai dit à mon chef de service que je ne ferais plus d’avortements. Il a compris et je n’avais plus à tuer, mais tout n’a pas été OK tout de suite. J’ai commencé à collaborer avec les mouvements pro-vie. Je me suis mis à orienter les femmes qui voulaient tuer leur enfant vers des psychologues. Ce devait être pour elles un temps de réflexion. Quand une femme renonçait à se faire avorter, elle pouvait aussi recevoir de l’aide de l’Église.
Comment êtes-vous sorti de votre syndrome ?
Il est toujours difficile de se relever d’une telle ruine morale. Chez moi, cela a duré à peu près un an. Il a d’abord fallu que je mûrisse à l’idée de parler de ce que j’avais fait. Je devais en premier lieu le reconnaître moi-même : «C’est moi qui réalisais ces avortements».
Vous êtes-vous pardonné ?
Je préférerais ne pas répondre à cette question… Je ne sais pas. Je suis capable d’en parler, je ne cache pas mon passé mais je n’en suis pas fier. C’était la pire période de ma vie. Cela m’a aussi appris à ne pas juger les autres hâtivement. J’avais ma part de responsabilité. Je ne sais pas si ces femmes qui pleuraient dans mon cabinet avant l’avortement m’ont pardonné. Ne vont-elles pas se souvenir de moi jusqu’à la fin de leurs jours ? Peut-être étaient-elles venues dans l’espoir de m’entendre dire une parole sage qui les inciterait à renoncer ? Parmi les centaines de cas auxquels j’ai eu affaire, cela a forcément dû arriver.
Désormais vous défendez la vie. Qu’est-ce qui est le plus important dans cette démarche ?
Éduquer et convaincre les gens que l’enfant conçu, ce n’est pas des “tissus” dans “mon utérus” mais bien une personne humaine concrète.
Et que doit-on faire quand la grossesse met en danger la vie de la mère ?
Cela arrive extrêmement rarement. Personnellement, depuis cette époque, je n’ai interrompu aucune grossesse alors que j’ai eu des cas désespérés. Je me souviens d’une dame en 1989 qui était atteinte d’un cancer disséminé du tube digestif et qui était tombée enceinte. On lui avait dit que si elle n’interrompait pas sa grossesse elle ne survivrait pas. Ma seule question, c’était : «Aura-t-elle le temps de faire naître son enfant ?». Je savais que la poursuite ou non de sa grossesse n’allait rien changer à son état de santé. Un mois avant l’accouchement, j’ai vécu un choc : j’ai senti une tumeur cancéreuse à proximité de son utérus. J’ai assisté à la naissance de son enfant en bonne santé et à sa mort à elle. Je sentais que c’était mon devoir d’être présent à son chevet puisque nous avions fait naître son enfant ensemble. C’était un acte héroïque de sa part même si elle n’avait pas ce sentiment elle-même. Elle est partie sereine et n’avait de prétentions envers personne. Je ne sais pas si elle aurait été dans la même disposition après un avortement, si elle aurait ressenti la même chose.
Vous avez parlé des sensations terribles qui accompagnent la vue des enfants avortés. Et que ressentez-vous en voyant un enfant venir au monde ?
C’est pour moi le plus beau des moments. Tous ces efforts pour accompagner l’accouchement, pour gérer tout ce stress chez la femme et chez soi-même. Et ensuite, la vue de ce nouvel être humain !
Visionner le film documentaire Le cri silencieux (à ne pas montrer aux enfants et aux âmes sensibles !) :
Première partie :
Deuxième partie :
Version originale de l’entretien : Byłem jak doktor Jekyll i mister Hyde, Gość Niedzielny n° 27/2007
Lire aussi :
- Avortement : avec Najat Vallaud-Belkacem, la novlangue devient définitivement le langage officiel de la République
- En adoptant son avant-projet de loi de protection de l’enfant conçu, le gouvernement espagnol s’engage dans la voie tracée par la Pologne il y a vingt ans
- Le ministre de la Justice espagnol, à propos du projet de loi sur l’avortement : «cette loi nous situera à l’avant-garde du XXIe siècle et elle va rouvrir le débat ailleurs en Europe»
- La justice polonaise s’en prend au financement du planning familial par l’industrie de l’avortement




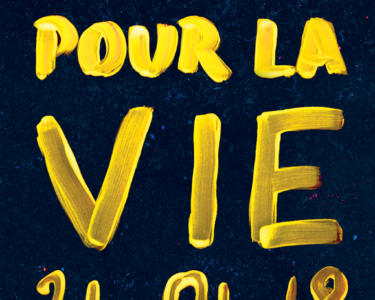
31 Comments
Comments are closed.