Si un auteur contemporain mériterait bien d’entrer à l’Académie française, c’est Jean Raspail. Loin des récits sans récit, des romans à la sauce “moi, je”, des nouvelles agrémentées de force détails obscènes ou simplement triviaux, les œuvres de Raspail nous emmènent dans des terres lointaines en partie mythiques, chevauchant botte à botte avec des margraves en rupture de ban et des abbés menant leur dernière croisade, pour la civilisation.
Raspail fait rêver et porte l’esprit de son lecteur vers des sentiments élevés de don de soi (dans Sire par exemple), de courage au milieu du chaos (dans Le Camp des saints), de respect religieux envers la lignée (dans Hurrah Zara), d’esprit hussard qui vaincu répète encore comme le roi François Ier au soir de Pavie ; “Tout est perdu, sauf l’honneur.” (dans le recueil Les Hussards, justement).
Mais c’est peut-être sur ce dernier point que l’on bute. Chez Raspail, tout est perdu. Tout est perdu en permanence, et il ne semble plus y avoir aucun espoir, ni aucune autre attitude possible que de bien réussir sa sortie, avec panache. C’est un poison bien Français, qui consiste, ayant compris que la défaite était inéluctable, à vouloir au moins conserver sa belle allure. Comme dit Cyrano, et Raspail l’a sans doute lu et relu, ce vers ; “Que dites-vous ? C’est inutile ? On ne se bat dans l’espoir du succès. C’est bien plus beau quand c’est inutile.”
Mais justement, ce vieux corsaire royaliste, cet indomptable mousquetaire n’aurait-il pas dû plutôt méditer cette maxime de Guillaume d’Orange, grand conquérant de trône devant l’Eternel : “Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.”
En effet, si on prend les œuvres citées plus haut, on retrouve toujours cette atmosphère prenante d’apocalypse. Dans Sire, la France à feu et à sang, prisonnière d’une inexorable décadence, assiste, inconsciente, au sacre inutile de Philippe-Pharamond, sacre clandestin, conclusion d’une fabuleuse chevauchée au cœur du royaume blessé. Philippe-Pharamond devient roi. Il est thaumaturge et guéri un pauvre enfant handicapé. En ce sens, il sème une fleur d’espérance. Une seule ! Car à peine est-il roi, qu’il retombe dans l’anonymat. S’en est fini. Le geste fut magnifique mais il demeure inconnu, il y a un roi, mais il n’y aura pas de royauté, et la France poursuit sa chute.
Dans Le Camp des saints, la situation est pire encore, puisque ce n’est pas seulement la France, mais tout l’Occident qui s’effondre d’un coup, pris entre le flot immense de l’immigration et sa propre lâcheté. Dans le désastre le gouvernement se tait, les journalistes se vendent à l’ennemi, les Français terrorisés se couchent devant l’envahisseur, les soldats mettent bas les armes sans s’être battus, l’Eglise joue les agents démoralisateurs à grands coups de tiers-mondisme larmoyant et les hippies de l’après 68 se livrent au pillage et à la destruction.
Il ne reste qu’un petit groupe de soldats, un diacre, un journaliste, un indien et celui dont on devine qu’il pourrait être Raspail, retirés dans un mas provençal, protégeant leur petit réduit contre l’invasion et les Français “bougnoulisés” pour reprendre le terme de l’auteur. Mais ils meurent lamentablement, tués par des avions français, et le récit se termine quelques décennies plus tard, sur l’ouverture des frontières de la Suisse, dernier bastion de l’Europe, à l’invasion étrangère.
Il n’y avait donc aucun espoir, du début à la fin, dans ce livre qui se voulut et fut en partie prophétique.
Dans Les Hussards, chaque nouvelle se termine par un désastre. “La passation de pouvoir” se termine par le geste inutile et cynique du Président sortant qui, tuant son successeur, sauve la France d’un minable, tout en reconnaissant l’avoir été, et brise sa carrière à venir au service de la patrie. “In partibus infidelium” s’achève par la mort en martyr de l’honnête prélat nommé évêque in partibus d’un diocèse perdu de Syrie, alors que l’évêque, parti incognito reconnaître son diocèse fictif, y dit la messe, revêtu de la chasuble rouge du martyr, devant la foule musulmane. Il meurt dans l’instant. Mais Raspail nous trompe. Ce n’est pas le martyr tel que l’Eglise le définit. Ce n’est pas le martyr des saints. Le bon évêque est partit clandestinement en sachant qu’il poserait là un geste ultime, plein d’allure, mais surtout provocateur, loin du témoignage de la vie donnée par amour de Dieu et de ses enfants. Et on pourrait continuer la liste encore avec “les Hussards de Katlinka” ou la “Domination”. A chaque fois, l’histoire est une véritable légende dorée propre à ragaillardir les âmes les plus assoupies. Mais tout le temps, il semble qu’à la fin l’espoir soit perdu.
Hourrah Zara est, en son genre, un chef d’oeuvre de cet état d’esprit. Dans la geste de Raspail, l’histoire des Pikkendorf, famille de margraves allemands sortis tout armés de son imagination avec son blason, son arbre généalogique et ses faits d’armes, est remplie de héros et de légendes magnifiques. Mais lorsque le dernier des comtes de Pikkendorf achève son récit, son ami découvre que loin d’avoir mené l’existence brillante et tumultueuse qu’il aimait conter, il n’était qu’un pauvre faiseur, ruiné et vivant de ses rêves. Quant à sa famille, si elle existe bien, on se prend alors à douter sur la réalité de telle ou telle anecdote. C’est l’art du conteur qui s’évente. Le nuage se dissipe et il ne reste plus qu’un beau rêve.
En dépit de tout, l’œuvre de Raspail est belle. Il nous entraîne à cheval avec lui dans les plaines interminables de la Borée. Nous vivons en Européens et humons à pleins poumons l’air de la liberté vécue entre hommes. Il est un poète viril, dernier conteur, désabusé, de la puissance occidentale. Il est le spectateur déçu d’un monde qui s’en va, le sien, le nôtre, et dont il rapproche celui de tant de peuples disparus au cœur de l’Amérique ou de l’Afrique.
On sort de sa lecture la tête pleine d’images. On le lit et on a envie de le relire. Oui, c’est un grand auteur qui mériterait, dans une meilleure France, une plus grande considération. Mais un croc d’aspic se loge en notre cœur, sans que nous le voyions, lorsque nous le lisons.
C’est dans cette belle fleur que se niche le poison. Raspail est intoxiqué par le venin du désespoir et il nous le transmet dans ses œuvres. Cela est d’autant plus dommageable que son lectorat de prédilection est une ardente jeunesse catholique, qui, en le lisant, pourrait bien parfois être tentée de pêcher contre l’Espérance. Pourtant, l’Espérance se niche dans chaque berceau, dans les conversations, dans le murmure des prières isolées, dans le mouvement des peuples en marche, au creux des livres et sur les autels. Nous avons bien vus, en France, l’an passé, ce que pouvait soulever l’Espérance ! Notre histoire nous a montré ce que pouvait faire notre peuple. Alors, peut-être que cette bataille est la dernière. Mais tant que le dernier carré ne s’est pas rendu, nous le savons bien, quand nous étudions notre passé, la pièce n’est pas encore dite.
Extrait de “In partibus infidelium” dans Les Hussards, Robert Laffon, 1982 :
“Le lendemain, une heure avant le lever du soleil, il quitta le Zerraco-Palace, sa valise à la main, traversa l’esplanade, et, se repérant dans la nuit, retrouva sans mal le maître-autel de la basilique. Là, calmement, il ouvrit sa valise, revêtit une chasuble rouge, disposa sur l’autel un missel de poche, deux bougies, un calice, une patène, des burettes, une hostie, coiffa sa mitre et après un large signe de croix entreprit le plus naturellement du monde de célébrer la messe. Un petit ânier qui dormait entre deux colonnes, s’éveilla et contempla la scène, médusé, pétrifié. Monseigneur Gautier lui sourit et il semble que le jeune garçon lui ait rendu son sourire.
A l’ite missa est, le jour était levé. C’était un vendredi. Prosterné vers La Mecque, une foule énorme attendait sur l’esplanade l’appel matinal du muezzin. Elle tournait le dos à la basilique. Sans doute quelqu’un dans la foule, attiré par une présence insolite, jeta-t-il un regard derrière lui… Un frisson d’horreur parcourut la multitude, une onde d’indignation, une clameur qui mit en mouvement un océan de colère… Dans tous les pays du monde, lorsqu’ils forment une foule, les hommes ne se maîtrisent plus. Nul ne revit jamais Monseigneur Gautier.
L’affaire fut étouffée pour trente six raisons d’État. Le Vatican resta muet. A la curie, ceux qui faisaient profession de savoir évoquèrent tristement un dérangement d’esprit. L’émir de Zerraco piqua une sainte colère et coupa le pétrole pour quinze jours. Les Français n’imaginèrent jamais pour quel motif réel ils durent se passer d’essence un Week-end. La fille aînée de l’Église a besoin de pétrole. Elle n’a pas besoin de martyrs.
Un mot encore. Retenus par la police de Zerraco, les touristes qui accompagnaient Monseigneur Gautier ne purent quitter le pays qu’après avoir juré qu’ils ne connaissaient pas cet homme-là.
Le coq avait chanté trois fois…”
> Gabriel Privat anime un blog.



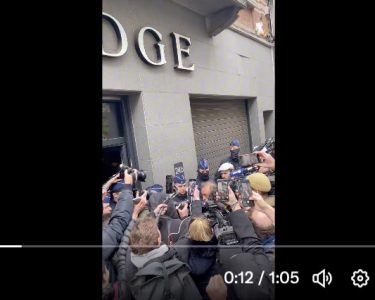

20 Comments
Comments are closed.